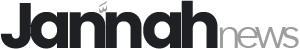Emploi et handicaps : entre acquis et nouveaux leviers – enseignements de l’étude IFOP menée par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP
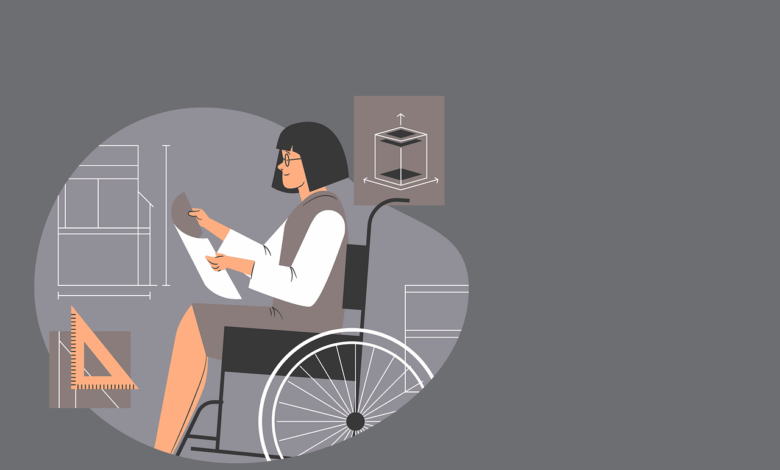
| À l’occasion de la 29ᵉ Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), organisée du 17 au 23 novembre par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, les trois partenaires présentent les résultats de l’étude IFOP 2025, réalisée auprès de plus de 7 800 personnes.Elle dresse un état des lieux inédit du monde du travail pour les personnes en situation de handicap et souligne les enjeux d’un emploi plus inclusif et respectueux de la santé mentale. |
Les enseignements majeurs de l’étude
1 – La loi de 2005 : une avancée reconnue mais insuffisante face aux attentes d’égalité réelle
Vingt ans après son adoption, la loi du 11 février 2005 reste un jalon essentiel pour les droits des personnes en situation de handicap, mais ses effets concrets demeurent limités. 60% des personnes en situation de handicap interrogées reconnaissent des avancées, mais seules 12 % évoquent de
« véritables changements majeurs ».
Pour beaucoup, l’égalité professionnelle signifie avant tout « être reconnu pour ses compétences sans préjugés » (41 %). Le principal combat n’est donc plus juridique, mais sociétal : il s’agit désormais de faire évoluer le regard porté sur le handicap. Cette perception mitigée traverse l’ensemble des situations, avec une satisfaction particulièrement faible chez les personnes en situation de handicap psychique (55 %) et celles vivant avec un multi handicap (53 %). Ces résultats traduisent un décalage entre le cadre législatif et la réalité vécue sur le terrain.
2 – L’insertion professionnelle et le recrutement : un parcours du combattant sous contrainte de discrétion
L’accès à l’emploi demeure semé d’embûches. Du CV à l’entretien, le parcours des personnes en situation de handicap reste marqué par des pratiques qui alimentent la méfiance : refus sans explication (81 %), questions intrusives (57 %), et même injonction à taire certains aspects de sa situation (62 % reconnaissent cacher des éléments de leur handicap).
Cette stratégie de discrétion s’enracine dans la crainte d’un tri implicite ou d’un malentendu sur les compétences. Plus d’un tiers des répondants (36 %), et jusqu’à 40 % parmi ceux ayant un handicap psychique, choisissent de ne pas déclarer leur handicap lors du recrutement. Ce non-dit a des conséquences lourdes : il prive d’emblée des aménagements utiles et fragilise les débuts de parcours.
Ces chiffres montrent que le handicap reste trop souvent perçu comme un risque dans le processus de recrutement, quand il devrait être considéré comme une donnée ordinaire de la diversité des profils.
3 – L’ambition bridée : quand l’autocensure limite les horizons professionnels
Une fois en poste, la carrière des personnes en situation de handicap reste marquée par un plafond de verre difficile à franchir. 70 % d’entre elles n’ont obtenu aucune promotion au cours des cinq dernières années, contre 58 % dans la population salariée française. Cette stagnation n’est pas seulement subie : elle s’intériorise. Lors de leur recherche d’emploi, seules 56 % des personnes interrogées déclarent accorder de l’importance aux perspectives d’évolution, contre 65 % des autres collaborateurs.
Ce phénomène d’autocensure trouve sa source dans l’expérience quotidienne : près d’une personne sur deux (46 %) identifie les transitions professionnelles comme le moment où son handicap pèse le plus. Changer de poste ou d’employeur signifie souvent perdre les aménagements acquis et devoir recommencer le parcours d’adaptation. La mobilité professionnelle devient alors synonyme de fragilité plutôt que d’opportunité. L’ambition se heurte à la crainte de devoir tout reconstruire.
4 – L’inclusion à plusieurs vitesses : quand la taille et les moyens déterminent la qualité de l’adaptation
L’étude met en évidence des écarts considérables selon la taille et la structuration des employeurs. Les cadres (75 %) et les collaborateurs travaillant pour des employeurs de plus de 250 personnes (71 %) disposent plus souvent d’outils adaptés, contre seulement 43 % des ouvriers. Ces disparités révèlent une inclusion à deux vitesses, où les grandes organisations offrent des conditions d’adaptation plus favorables, tandis que les PME et les emplois peu qualifiés restent en retrait.
Le rôle du référent handicap s’impose ici comme un facteur déterminant. Sa présence transforme significativement l’expérience vécue : 76 % des collaborateurs bénéficiant d’un référent disposent d’outils adaptés, contre 53 % lorsqu’il n’y en a pas. Le référent handicap agit comme un véritable levier d’égalité, en permettant la mise en place effective des aménagements, en favorisant la formation et en créant un climat de confiance. Ces écarts massifs appellent à une généralisation du dispositif pour garantir un accès équitable aux moyens d’adaptation.
5 – L’insécurité psychologique au travail : le prix caché de la différence
Derrière les progrès législatifs et organisationnels, l’étude met en lumière une fragilité persistante : l’insécurité psychologique. Seulement 67 % des personnes en situation de handicap se sentent en sécurité pour signaler un problème sans craindre de représailles, contre 73 % des collaborateurs en général. Plus inquiétant encore, 58 % d’entre elles déclarent ne pas pouvoir évoquer leur santé mentale sans redouter des conséquences négatives.
Ce climat de réserve conduit de nombreuses personnes à accorder une importance accrue aux valeurs de l’organisation. Lors de la recherche d’emploi, elles se montrent particulièrement attentives à la bienveillance de l’employeur (76 % contre 70 % des collaborateurs) et à sa politique d’inclusion (69 % contre 54 %). Ces chiffres traduisent une attente de cohérence : l’inclusion doit être visible, vécue et incarnée.
Le paradoxe de “l’invisibilité forcée” en découle directement : pour se protéger, 36 % choisissent de ne jamais déclarer leur handicap lors du recrutement, un chiffre qui atteint 40 % chez les personnes en situation de handicap psychique. Cette autocensure souligne combien la sécurité psychologique demeure la condition première d’un travail réellement inclusif.
Regards croisés et enseignements pour les employeurs
Les résultats de l’étude montrent que l’inclusion reste un défi collectif, qui dépasse la seule volonté individuelle. Les femmes en situation de handicap renoncent plus souvent à une évolution, faute d’appui ou par peur du regard. Les seniors, plus confiants dans l’esprit de la loi de 2005, rencontrent encore des freins à la reconversion et à la formation.
Ces constats rappellent que la vulnérabilité des personnes en situation de handicap n’est pas une fragilité personnelle mais un révélateur du fonctionnement d’un collectif. Un environnement de travail réellement inclusif – doté d’un référent handicap, attentif à la santé mentale, ouvert au télétravail et garant d’une reconnaissance équitable – bénéficie à tous les collaborateurs.
Face à ces enjeux, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP appellent les employeurs à renforcer la culture de l’inclusion en :
- généralisant la présence d’un référent handicap dans toutes les organisations ;
- développant la pratique de l’aménagement raisonnable (adaptation des outils, compensation, télétravail) ;
- valorisant les compétences au-delà des préjugés, notamment à travers l’équité salariale et les promotions ;
- et en formant les managers à l’accompagnement des troubles psychiques et à la santé mentale au travail.
Une mobilisation collective pour l’égalité réelle
La SEEPH 2025 invite l’ensemble des employeurs, publics comme privés, ainsi que les partenaires sociaux et les institutions, à traduire ces enseignements en actions concrètes.
Vingt ans après la loi de 2005, l’ambition reste la même : permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder, de se maintenir et de progresser dans des collectifs attentifs, où la santé mentale et l’inclusion sont reconnues comme des leviers de performance durable.
LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP réaffirment leur engagement commun pour construire, ensemble, un monde du travail accessible, bienveillant et porteur d’égalité.
| « Handicaps et emploi, l’égalité pour toutes et tous ! » : la thématique 2025 est tournée vers l’avenirLa SEEPH 2025 met en dialogue trois enjeux majeurs :L’héritage vivant de la loi du 11 février 2005, qui fête cette année ses 20 ans ;L’accessibilité universelle et la compensation effective sur les lieux de travail ;La santé mentale, grande cause nationale 2025, et l’inclusion des handicaps psychiques.Cette approche invite à dépasser le bilan historique pour interroger : comment garantir que chaque collaborateur, qu’il soit ou non en situation de handicap, puisse évoluer selon ses compétences dans un collectif soutenant ? Le dépassement historique porté par la SEEPH 2025 vise à élargir le cadre d’étude par une reconnaissance effective des handicaps psychiques. |
| MéthodologieL’enquête a été conduite en juin 2025 auprès de quatre échantillons :1 000 personnes représentatives de la population française ;1 007 collaborateurs ;5 446 personnes en situation de handicap ;413 employeurs et responsables RH. Les échantillons se distinguent par leur taille remarquable, leur représentativité croisée (grand public, collaborateurs, employeurs, personnes concernées) et la diversité des profils interrogés.Les résultats 2025 complètent ceux publiés en 2024, permettant de suivre l’évolution des perceptions, des parcours et des conditions de travail. |
Pour Bruno Pollez, président de LADAPT : « Cette étude montre qu’inclure, ce n’est pas seulement adapter un poste, c’est créer un climat où chacun peut parler de sa réalité sans peur ni malaise. Là où la confiance s’installe, les talents s’expriment et le collectif s’enrichit. Les résultats rappellent aussi l’importance de l’accompagnement : rôle du référent handicap ou des dispositifs comme l’emploi accompagné, véritables repères pour les salariés comme pour les employeurs. En plaçant la confiance et le bien-être au cœur du travail, on construit des environnements vraiment inclusifs, qui profitent à tous. »
Pour Françoise Descamps-Crosnier, présidente du Comité national du FIPHFP : « Vingt ans après la loi de 2005, cette étude IFOP nous rappelle que l’inclusion ne peut se limiter aux intentions : elle doit se vivre au quotidien dans chaque équipe, chaque service. Le FIPHFP agit pour que la Fonction publique soit exemplaire, en plaçant la confiance, la santé mentale et l’adaptation des environnements de travail au cœur de ses priorités et en formant et outillant les référents handicap pour leur donner les moyens d’accomplir leur mission. »
«Cette étude conforte les convictions de l’Agefiph, estime Christian PLOTON, président de l’Agefiph. La place du handicap dans l’emploi est l’affaire de tous. Car, comme la santé mentale, le handicap peut toucher tous les collaborateurs quel que soit sa fonction. C’est ensemble que nous pouvons faire bouger les lignes.»