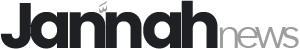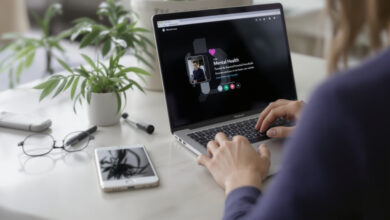La réussite des études en physiothérapie : un miroir des praticiens de demain ?

Par Inès Ravaz, Présidente d’Europe Eduss,
12 300 étudiants, c’est environ le nombre d’inscrits chaque année en France dans les quelque 50 instituts de formation en Masso-Kinésithérapie. Une quantité insuffisante en raison de la demande croissante du besoin de professionnels dans ce secteur. Selon le rapport démographique pour l’année 2024, établi par le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, ce secteur a connu une augmentation notable de 16,3 % par rapport à 2020. Avec 109 000 kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre au 1er janvier 2025 répartis de manière inégale sur l’ensemble du territoire, certains départements souffrent d’une sous-représentation de la profession. C’est le cas pour le Centre-Val de Loire et la Normandie. Même constat pour les DOM-TOM comme Mayotte et Guyane dont les situations restent préoccupantes en termes d’accès aux soins. En cause? La croissance démographique, le vieillissement de la population et l’augmentation de la demande de soins entraînent un besoin toujours plus fort de nouvelles recrues. Comme dans d’autres professions médicales et paramédicales, cette carence est comblée par le choix de faire appel aux diplômés d’autres pays de l’espace Schengen. En 2022, ils étaient 27 655 à exercer en France grâce au dispositif de libre circulation. L’évolution des formations de kinésithérapeute au cours des dernières années met en lumière des parcours d’apprentissage différents au sein de la zone euro.
Les études de kinésithérapie : reflet des disparités des programmes des membres de l’UE.
La stratégie d’accès aux études médicales au sein des 27 membres de l’UE n’est pas similaire d’un pays à l’autre. On dénombre deux types de parcours. D’une part, certains pays proposent d’accéder à ces formations à travers des baccalauréats, licences ou masters spécifiques (B.Sc. M.S.c). C’est le cas de la Pologne, de la République tchèque, de l’Allemagne, de l’Irlande, des Pays‑Bas, de la Belgique, du Portugal, de la Hongrie, de l’Irlande, du Luxembourg, de l’Italie et de Chypre. D’une durée de 3 ou 5 ans, ces dernières sont accessibles dès le bac avec sélection sur dossier (notes, motivation, tests). Plus proches des “codes” de l’enseignement secondaire, elles permettent de pouvoir bénéficier de classes plus petites et de contenus dispensés ciblés.
D’autre part, certains pays mettent en place une sélection intégrée ou un concours afin de départager les candidats. C’est le cas en France, dont l’entrée se fait via le PASS ou L.AS (5 ans), mais également en Espagne avec le système Pruebas de Competencias Especificas PCE, et dans certains cas italiens qui proposent aux étudiants de réaliser une épreuve à 80 questions pour être accepté. L’objectif de ces systèmes d’admission est de favoriser un numerus clausus, à travers des tests de présélection.
Une différence de critères de sélection qui dévoile une conception et représentation plus ou moins élitiste de l’accessibilité à ces cursus.
Le système français : concourir pour réussir ?
L’accès à certaines formations par concours révèle la perception nationale très sélective de l’apprentissage et de la professionnalisation aux différentes carrières de la santé. L’un des exemples les plus marquants est le système français. Le cursus PASS – LAS, dont l’objectif initial était d’éviter le favoritisme en comparant équitablement les candidats sur un ensemble de critères mesurables, favorise – in fine – des parcours très scolaires à travers un programme riche en connaissances théoriques variées. Cette approche très académique se retrouve également dans les examens qui mettent en avant la mémorisation par le biais de la résolution de QCM, au détriment de la créativité, du savoir-être et des compétences pratiques.
Conséquence ? Le concours qui opère un classement parmi les étudiants fait naître une rivalité entre ces derniers. La sélection des meilleurs profils instaure un climat très compétitif qui peut être tout autant stimulant que destructif. Pour beaucoup d’apprenants, la période des épreuves est synonyme de stress intense et de pression psychologique. Des symptômes qui se traduisent par de l’anxiété, des troubles du sommeil et des problèmes de santé.
En amont des examens, poussés par la compétition, les candidats se tournent souvent vers des cours privés spécialisés, transformant l’accès au concours en business lucratif. Une culture du coaching qui reflète à nouveau des inégalités socio-économiques et qui pénalise les candidats issus des milieux plus modestes qui ne peuvent bénéficier des mêmes préparations aux examens faute de moyens.
Point d’orgue de cette compétition, l’obtention de bourses et d’opportunités dans des institutions prestigieuses. Censées être un levier pour inclure des apprenants de tout horizon, ces dernières bouclent le cycle de la sélection opérée en récompensant la théorie plutôt que la pratique.
Depuis l’adoption de la directive 2005/36/CE, les diplômes de kinésithérapie sont reconnus dans l’intégralité de l’espace économique européen, sous réserve d’être conformes aux standards (durée, contenu). Grâce à une attestation de conformité, le jeune praticien peut être autorisé à pratiquer sans examen complémentaire dans n’importe quel pays de l’Union Européenne. Enfin, la carte professionnelle européenne (EPC) facilite la reconnaissance électronique des qualifications des kinésithérapeutes entre États membres depuis 2016.
Autant de raisons, qui laissent la possibilité aux lycéens issus de parcours atypiques de poursuivre leurs projets professionnels. Chaque année, ils sont plusieurs centaines à faire le choix de se tourner vers une destination de l’espace Schengen pour se former.
Face à l’accroissement de la désertification médicale, repenser l’accessibilité des parcours est indispensable. Créer des vocations et non plus de la compétition. Une conception qui permettra de faire émerger une plus grande démographie médicale et une meilleure représentation de la diversité des praticiens pour répondre aux enjeux de demain.